Imaginez enseigner avec passion, publier avec rigueur, intervenir dans le débat public… tout en sachant que ces actions pourraient négativement impacter le renouvellement de votre contrat de travail. C’est la réalité vécue par une part grandissante du personnel universitaire. Derrière les murs de l’université, la précarité est trop souvent mise en œuvre comme un mode de gestion. Et elle pèse lourdement sur un principe fondamental : la liberté académique.
Dans son plus récent avis, le Comité permanent de la liberté académique (COPLA), formé des professeur·es Lucie Lamarche, Gilles Bronchti, Louis-Philippe Lampron et Pierre Trudel, lance un signal d’alarme : la précarité, lorsqu’elle n’est pas rigoureusement balisée et justifiée, compromet l’exercice même de la liberté académique. Elle transforme un droit en privilège conditionnel, fragilise l’audace intellectuelle, et pousse au silence certaines et certains qui devraient contribuer avec vigueur à la mission universitaire — soit à la production et à la transmission des savoirs au service du bien commun.
Voici quatre constats importants tirés de cet avis, qui révèlent les dérives systémiques et les risques réels d’un affaiblissement de la mission universitaire.
Table des matières
1. Une liberté proclamée… mais inapplicable pour trop de personnes
On célèbre la liberté académique comme une pierre angulaire de l’université. Elle est protégée par la loi, mentionnée dans les politiques, défendue dans les discours. Mais pour des milliers de personnes engagées dans la mission universitaire, elle demeure un droit théorique. Leur quotidien, lui, est marqué par la précarité.
Selon l’avis du COPLA, cette précarité prive nombre d’universitaires des garanties minimales pour exercer librement leur pensée. Car comment critiquer une orientation institutionnelle, publier un article controversé ou choisir un sujet de recherche audacieux… quand la sécurité de son emploi repose sur une décision reconduite chaque session ?
La Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire affirme que toute personne qui contribue à la mission de l’université doit pouvoir s’exprimer sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale. Mais cette promesse entre en collision avec une réalité bien connue : la précarité induit la peur. Et la peur fait taire.
Dans un contexte où moins de 40 % du personnel académique universitaire au Québec bénéficiait d’un statut permanent, la précarité devient une structure redoutablement efficace. Elle a le pouvoir de fragiliser la parole et d’encourager la conformité. Et, au premier chef, ce sont les voix les plus minorisées — celles des jeunes professeur·es, chargé·es de cours, chercheur·euses sans poste — qui en sont les premières victimes.
Le COPLA est sans équivoque : la précarité, lorsqu’elle n’est pas balisée et justifiée, constitue une limite structurelle à la liberté académique. On ne peut garantir la liberté d’expression intellectuelle tout en laissant persister des pratiques qui incitent au silence.
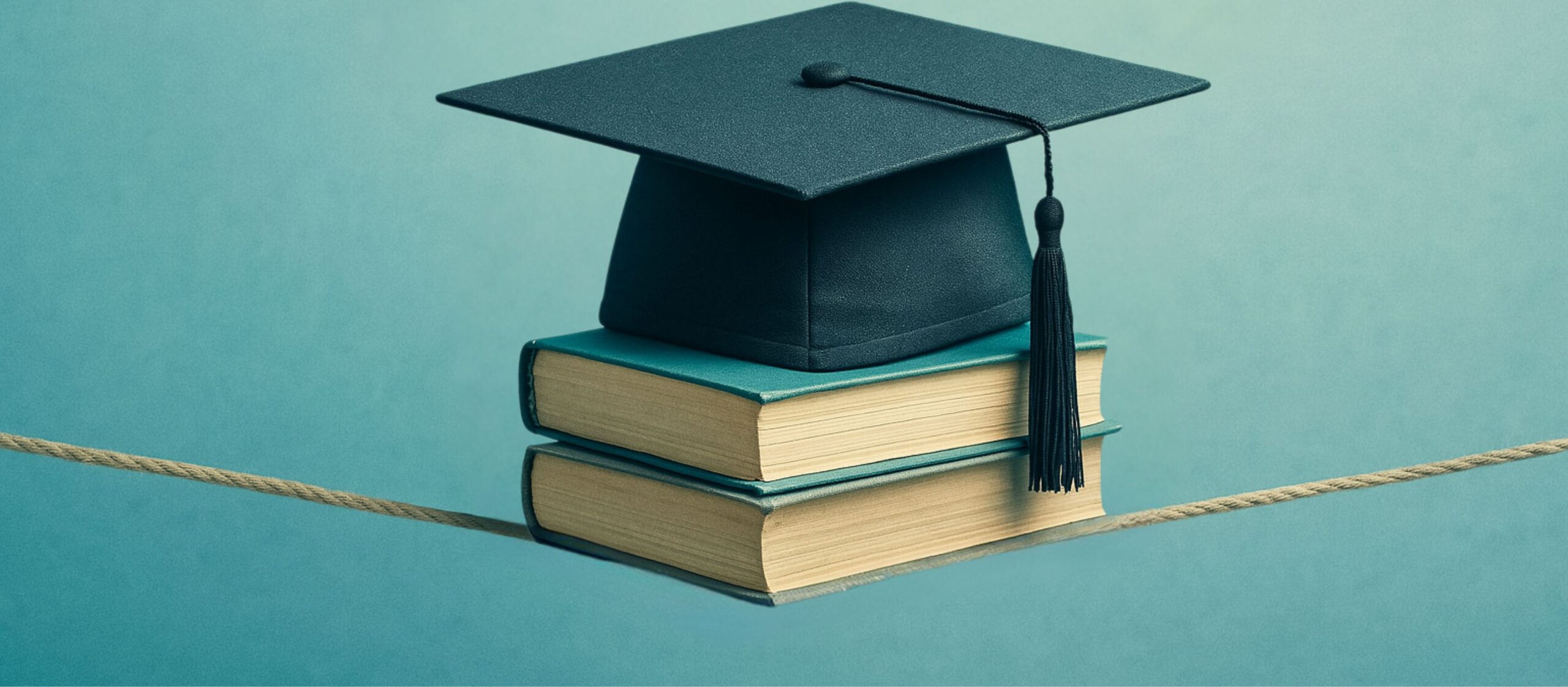
2. Un cadre qui ouvre la porte à l’arbitraire
La précarité à l’université n’est pas nécessairement décrétée par un texte réglementaire ou une politique. C’est souvent la résultante du fonctionnement d’instances actives au sein des institutions ou de contraintes auxquelles elles font face.
Mais lorsque les règles sont floues, ce ne sont pas seulement des carrières qui sont mises au ballottage — c’est la liberté académique elle-même qui vacille. Ce que l’avis du COPLA recommande est limpide : les universités doivent expliquer pourquoi une situation de précarité est imposée, en quoi elle est temporaire, justifiée et compatible avec la liberté académique. Elles doivent établir des règles claires, accessibles, compréhensibles.
La norme ne devrait jamais être implicite. C’est une question d’équité. C’est une question de confiance. Et c’est surtout une condition essentielle pour garantir une expression intellectuelle libre et plurielle.
💼 Vous voulez en savoir plus ? Lisez l’avis intégral du COPLA, « La liberté académique et les règles et pratiques imposant la précarité aux personnes contribuant à la mission universitaire ».
3. L’autocensure comme mécanisme de survie
Mettez-vous dans les souliers d’une personne n’ayant pas un statut permanent à l’université. Vous enseignez un sujet controversé, vous formulez une critique sur une décision institutionnelle, ou encore, vous signez une lettre ouverte dans un quotidien. Une question vous traversera nécessairement l’esprit : et si cela compromettait, d’une manière ou d’une autre, mon renouvellement de contrat ?
Cette inquiétude n’est pas théorique. Pour de nombreuses personnes en situation de précarité dans le milieu universitaire, prendre la parole est un acte risqué. C’est un secret de polichinelle : lorsqu’il n’existe ni balises claires ni protection effective contre l’arbitraire, le silence devient un réflexe de préservation. C’est ainsi que s’installe l’autocensure.
Ce phénomène est insidieux. Il ne se manifeste pas par des interdictions explicites, mais par une autocondamnation à la prudence. Par peur de heurter, d’irriter, de trop déranger, de dépasser une limite qui ne serait pas explicite. Résultat ? Le mutisme de voix essentielles au débat et à la production de nouveaux savoirs.
Cette forme d’autocensure est particulièrement préoccupante, car elle touche plus fortement des catégories spécifiques de travailleuses et de travailleurs : les jeunes chercheur·euses, les professeur·es en début de carrière, et potentiellement les personnes issues de groupes minoritaires — bref, de nombreuses voix émergentes et potentiellement critiques.
L’avis du COPLA souligne qu’un tel climat est incompatible avec la liberté académique, qui ne représente certainement pas un luxe pour les titulaires : elle est une condition essentielle pour que toutes les personnes engagées dans la mission universitaire puissent remplir leur rôle.

4. L’urgence de mieux encadrer la précarité
Au-delà des chiffres et des constats, la précarité constitue un problème dans la manière dont est structuré le travail à l’université. Un problème que trop de personnes vivent en silence. Après tout, derrière chaque condition précaire, l’on trouve possiblement une voix privée de sa pleine portée.
À ce titre, il faut cesser de voir la précarité comme un simple enjeu administratif ou budgétaire. Celle-ci doit aussi se concevoir, pour les administrations qui y ont recours, comme un choix politique. En ce sens, tant qu’elle restera traitée comme une fatalité ou une anomalie périphérique, rien ne changera.
Dans son avis, le COPLA appelle à un renversement de perspective : ce n’est pas à la personne précaire de s’adapter au système, mais au système de prouver que cette précarité est nécessaire, limitée, justifiable. Et surtout : compatible avec la liberté académique, ce pilier fondamental de l’université.
Il est nécessaire, en effet, de faire de la liberté académique un principe vécu, incarné, partagé — pas seulement un idéal brandi dans les discours institutionnels. Cela exige du courage. De la clarté. Et un engagement sincère à ne jamais faire le sacrifice d’une pleine expression du pluralisme intellectuel.
Restez à jour
Abonnez-vous à l’infolettre de la Fédération.


